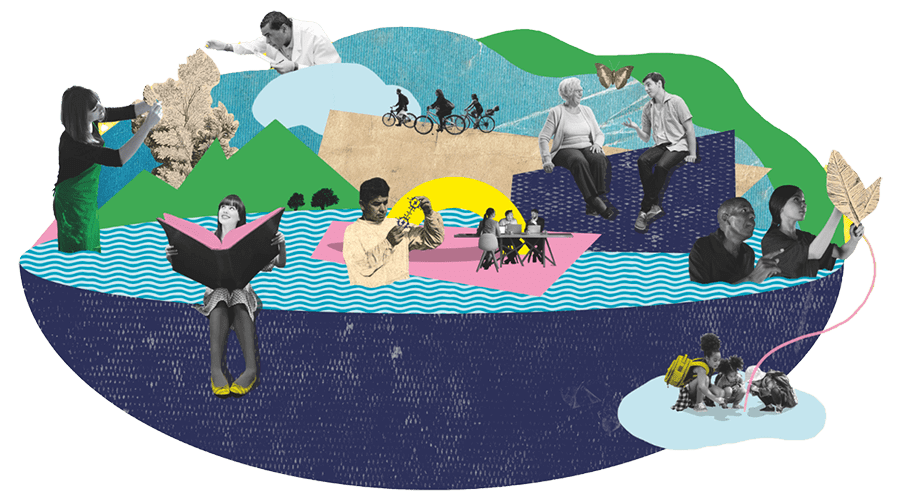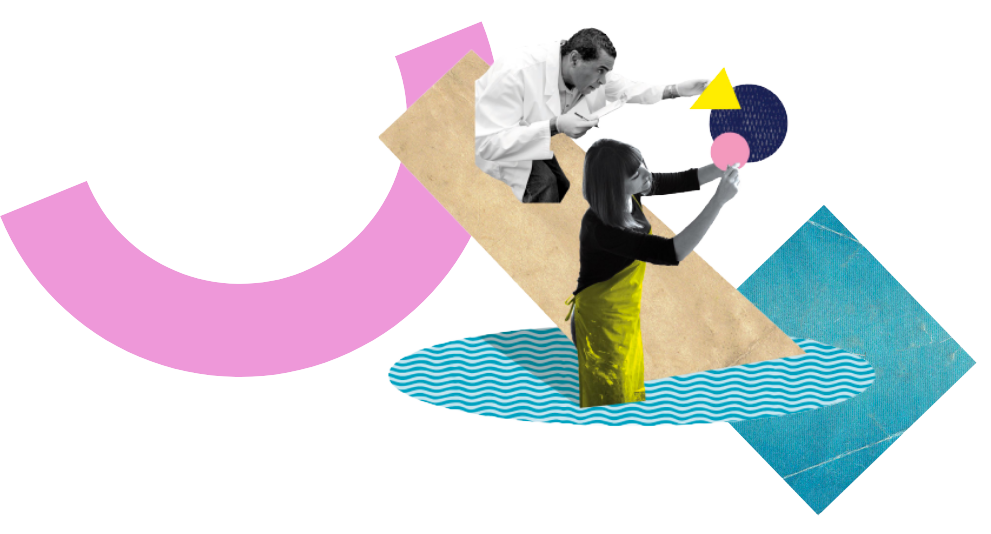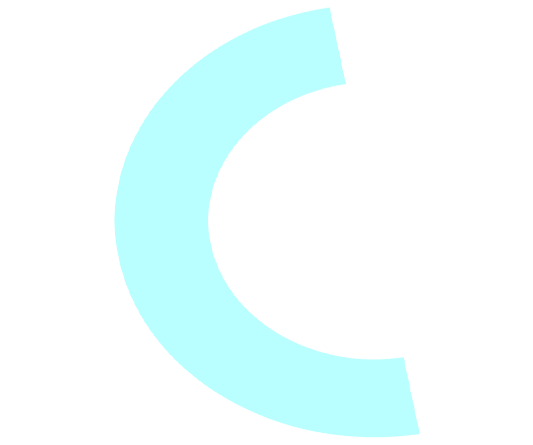
L’innovation sociale nécessite de penser hors des cadres et dont la forme, le fond et l’objectif varient selon le projet, les acteurs, le territoire, la période, la gouvernance…
Tout se crée et se transforme au fil du temps et de l’expérimentation.
C’est pourquoi il n’y a pas d’innovation sociale sans création, et pas non plus de création sans inspiration. Figurent ici les articles, tribunes et événements de nos collaborateur·trices ainsi que des auteur·trices qui nous inspirent. Bonne lecture !